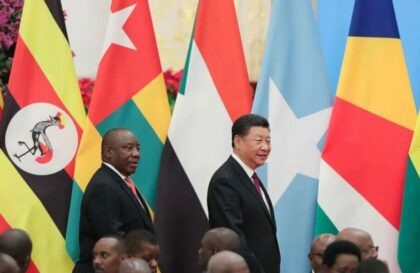« Il y a effectivement une lutte de classes, mais c’est ma classe, celle des riches, qui mènent cette guerre, et nous sommes en train de la gagner ». Les mots sont de Warren Buffett, investisseur et philanthrope américain et un des hommes les plus riches au monde, prononcés quelques années avant le déclenchement de la crise actuelle économique et financière.
La vérité est encore devenue plus limpide avec le déroulement de la crise, les banques et les institutions financières ont reçu 700 milliards de $ pour les « sauver » (une partie de cette somme scandaleusement utilisée en bonus versés aux responsables du krach financier), mais les travailleurs et leurs familles ont perdu leurs maisons, rencontrent des difficultés accrues au travail et subissent l’aggravation des inégalités sociales.
Pays des extrêmes
La crise n’a fait toutefois que renforcer des tendances de fond. Au cours des 30 dernières années, les inégalités salariales aux États-Unis ont considérablement augmenté, approchant le niveau atteint avant la Grande dépression. La différence entre les salaires les plus bas et le salaire moyen a fortement augmenté dans les années 1970 et 80, mais le principal moteur des inégalités est l’augmentation démesurée des revenus les plus élevés. Depuis 1979, les 10% les plus riches de la population se sont accaparés les deux-tiers de l’augmentation des revenus globale, et le 1% des salariés les plus riches se sont taillés un copieux 38,7% de ce gâteau. Le rapport du PNUD datant de 2009 sur les inégalités de revenus dans les économies avancées a placé les États-Unis juste derrière Hong-Kong et Singapour dans les pays où le fossé entre les revenus des plus pauvres et des plus riches est le plus grand (suivent Israël et le Portugal).
La disparité des 30 dernières années contraste avec la période précédente, de 1947 à 1973, phase de domination de l’économie mondiale et de croissance de la classe moyenne aux États-Unis. Durant cette période, les différentes strates économiques connaissent des taux de croissance de leur revenu relativement identiques. Avec le ralentissement de la productivité dans les années 1970, les revenus des ménages ont stagné, à la traîne par rapport au taux de croissance économique, c’est-à-dire que leurs revenus réels ont diminué tandis que les revenus les plus élevés ont explosé. Ces tendances n’ont pas été altérées en dépit d’une certaine reprise économique à partir des années 1990. Pourquoi ? Selon le Prix Nobel d’Économie, Joseph Stiglitz : « les économistes ne sont pas sûrs de l’explication à donner aux inégalités croissantes en Amérique, mais une grande partie de l’explication réside dans le fait que le 1% le plus riche les recherche, ces inégalités ».
Les tendances de la répartition des richesses ne se sont pas traduites juste par des inégalités relatives, mais en chiffres absolues de pauvreté. Les chiffres de la pauvreté se sont mis à augmenter, atteignant les 25% parmi les noirs et les hispaniques, plus du double que chez les blancs non-hispaniques. L’augmentation du chômage, qui est d’environ 9,5%, s’élevant à 16,2% parmi la population noire, est un des facteurs déterminants. En 2008-2009, le nombre d’emplois a diminué de 8 millions, chiffre supérieur à celui de toute autre récession antérieure. Mais le plus significatif, c’est la chute de la valeur réelle des revenus les plus bas. Entre 2007 et 2009, la proportion de ménages employés avec des bas revenus – moins de 200% du seuil officiel de pauvreté – a augmenté pour atteindre les 30%. Un ménage sur trois aux États-Unis, même s’il travaille, vit dans la pauvreté. Cette réalité touche 44 millions de personnes, dont 22 millions d’enfants, plaçant les États-Unis juste derrière le Mexique, parmi les économises avancées, avec 22% de ses enfants dans la pauvreté.
Les « nouveaux emplois » offrent généralement des bas salaires et ne comprennent pas d’assurance-maladie, ou de dispositif de retraite. Parmi les employés à temps plein, 10% offrent des bas salaires, 30% ne comprennent pas d’assurance-maladie et 40% de plan de retraite. Pour les travailleurs à temps partiel, service d’agences de travail temporaire, ou de travailleurs autonomes, on atteint des sommets. Près de 5% des travailleurs ont plus d’un emploi à temps plein.
L’aggravation des inégalités de revenus, dans les années de 1970 et 80, ne peut pas être déconnecté de deux autres processus liés : (a) Une chute du taux de syndicalisation, de 20%, en 1983, à 11,3% en 2010, avec des effets plus significatifs dans le secteur privé (où le taux est de 6,9% ; 7,1 millions de travailleurs) que dans le secteur public (36,2% ; 7,6 millions) ; (b) une chute du montant du salaire minimum et son incidence sur le marché du travail, des offensives permanentes contre les conventions collectives, ainsi que d’autres processus de dérégulation du marché du travail.
L’éclatement de la bulle du crédit mobilier a aggravé les disparités sociales, touchant tout particulièrement les membres des minorités noires et hispaniques. Les inégalités économiques entre ethnies sont encore plus profondes quand nous mesurons la richesse et non seulement le revenu, c’est-à-dire, quand nous intégrons la maison, la voiture, l’épargne et les investissements (moins les dettes liées au crédit mobilier, automobile ou aux cartes de crédit). Noirs et hispaniques ont moins d’actifs financiers, leur patrimoine dépendant plus étroitement de la valeur de la maison. En 2005, le ratio de richesse entre les Blancs et les Noirs ou les Hispaniques était de 10 pour 1. Aujourd’hui, c’est plus du double.
Alors que 75% des ménages blancs sont propriétaires de leur maison, ce chiffre n’était que de 50% pour les ménages noirs et hispaniques. Ces derniers ont constitué donc un marché pour écouler l’offre de produits financiers. Les banques et les agents financiers ont offert de préférence à ces familles des prêts sub-primes, avec des taux d’intérêt plus élevés et des conditions moins favorables, même quand les familles étaient éligibles à des prêts normaux. Lorsque le marché des valeurs mobilières s’est écroulé, à partir de 2006, ces ethnies ont été touchées de façon disproportionnée : en seulement trois ans, la récession a conduit à une diminution de 16% de la richesse des familles branches, mais de 53% parmi les familles noires, 54% parmi celles asiatiques et 66% parmi les Hispaniques. Contrairement aux espoirs suscités, la présidence d’Obama n’a pas constitué l’avènement d’une ère « post-raciale », mais a coïncidé avec le plus important recul économique des minorités ethniques sur les 20 dernières années.
Les travailleurs résistent
La récession économique a affecté les budgets de l’État, dont les revenus ont diminué en 2009 de près de 31%, soit 1 100 milliards de $. Pour 2011, 40 États envisagent un déficit total cumulé de 113 milliards de dollars, emmenant 46 États à augmenter les impôts, à couper dans les dépenses publiques et à mener une offensive contre les travailleurs et les syndicats du secteur public au nom de l’austérité. (Cela ne vous rappelle rien?).
C’est dans ce contexte que le Parti républicain a gagné la majorité au Congrès et le gouvernement de plusieurs États, aux élections de mi-parcours de 2010, et a lancé des offensives massives contre les droits des travailleurs. Scott Walker, nouveau gouverneur du Wisconsin, et John Kaisch, gouverneur républicain de l’Ohio, ont proposé la fin des conventions collectives et du droit de grève dans ce secteur. Le nouveau gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, a conclu en juin un accord quinquennal pour geler les salaires, mettre en place une banque d’heures et augmenter les cotisations pour l’assurance santé, et il a comme objectif de diminuer les retraites en 2012. Le nouveau gouverneur démocrate de Californie, Jerry Brown, remet déjà en question les avantages sociaux et les retraites des travailleurs de l’État (notons qu’aux États-Unis, les services publics – enseignement primaire, secondaire et supérieur, transports, énergie, santé, eau et égouts – sont gérés par les États et leurs communes, non par le gouvernement fédéral).
Les législateurs républicains dans 10 États veulent introduire des lois qui empêchent les syndicats du secteur privé de prélever automatiquement les cotisations des travailleurs qu’ils représentent, arguant que les syndicats tiennent les bons emplois en otage du paiement de leurs cotisations. Ils prétendent que les États « prisonniers des syndicats » perdent des sommes à investir dans les États où prévaut le « droit au travail », comme si la syndicalisation était une perte de liberté. Dans les emplois syndiqués, le salaire est en moyenne supérieur de 200 $.
Le National labour relations act (NLRB), en 1935, protège le droit des travailleurs du secteur public à la syndicalisation (tout en créant d’énormes obstacles), mais il laisse à chaque État la décision d’autoriser la syndicalisation des travailleurs de son secteur public. Cela a été permis dans les États de la côte Est et au Centre-nord, comme ce fut le cas du Wisconsin et de l’Ohio, avec une tradition industrielle. Les travailleurs des secteurs publics ont seulement commencé à s’organiser et à se syndiquer dans les années 1960 et, en dépit de la chute générale du taux de syndicalisation, ce secteur représente désormais la majorité des travailleurs syndiqués.
C’est dans ce contexte historique que les leaders de droite ont parlé des avantages, privilèges et droits excessifs des travailleurs du secteur public, cherchant à les opposer à ceux des travailleurs « moins privilégiés » du secteur privé. Ce discours a eu son petit effet, avec des cas de négociations séparées avec les syndicats du secteur privé et public, par exemple dans le secteur de la santé, l’État essayant de jouer les uns contre les autres.
Mais ces attaques ne sont pas restées sans réponse. Au début de l’année, le Sénat du Wisconsin (avec une nouvelle majorité républicaine) a adopté toute une série d’exonérations fiscales au profit des multi-nationales et des grandes entreprises. En Février, le gouverneur Walker a annoncé la nécessité de diminuer les dépenses et a proposé, sans la moindre concertation sociale, des coupes dans les salaires, les retraites et les avantages sociaux des travailleurs du secteur public, supprimant ainsi leurs droits à la négociation collective (le Wisconsin a adopté, en 1959, la Loi sur la négociation collective étendant les droits syndicaux du National act aux travailleurs du secteur public de l’État).
Dans une sombre manœuvre, Walker avait placé la Garde nationale d’État en état d’alerte pour faire face aux actions de protestation des travailleurs de l’État et des collectivités locales. Les manifestations ne se sont effectivement pas faites attendre. A quelques jours de l’annonce des mesures, le 14 février, 10 000 professeurs, étudiants entre autres ont manifesté face au Capitole de l’État, dans la ville de Madison. Cinq jours plus tard, ils étaient 30 000 à manifester devant l’édifice, contribuant à reporter le vote : les sénateurs démocrates abandonnant l’assemblée laissant le Sénat sans quorum. Le jour suivant, un samedi, 80 000 travailleurs ont manifesté pour défendre la négociation collective. Les policiers et les pompiers, d’abord exemptés des mesures du gouverneur, ont rejoint les autres travailleurs dans le mouvement pour protester et exprimer leur solidarité. Les sondages ont révélé une ouverte à la négociation concernant les coupes, mais une opposition ferme pour ce qui est de la défens des droits des travailleurs.
Les manifestations se sont étendues à l’État d’Ohio, où des milliers de travailleurs se sont rassemblés devant le Capitole à Colombus contre le Projet de loi 5, mesure qui exige des travailleurs de l’État l’abandon des conventions collectives, l’augmentation des frais pour l’assurance-santé et la mise en place d’un système salarial basé sur le « mérite ». Le gouverneur Kaisch a menacé les travailleurs qui faisaient grève de les licencier. Les manifestations se sont étendues aux États d’Indiana et d’Idaho où se sont faits jour de nouvelles offensives contre les négociations collectives.
Les manifestations au Wisconsin devant le Capitole (et dans le bâtiment même) et dans tout l’État sont montées en puissance pendant 13 jours, atteignant la barre des 100 000, dans une des plus impressionnantes mobilisations de ces dernières décennies aux États-Unis. Le Sénat a adopté les mesures du gouverneur Walker dans la plus longue session de l’histoire de cette assemblée. Mais les manifestations et l’occupation du Capitole ont continué et la lutte a été portée devant les tribunaux. En Juillet, il y eut des signes qui ont filtré selon lesquels les travailleurs pourraient être licenciés et remplacés par des prisonniers. La population carcérale du Wisconsin a déjà été utilisée dans un nombre limité de projets de l’État, mais il existe désormais une plus grande liberté pour leur livrer des emplois auparavant réservés aux travailleurs syndicalisés. La lutte a ouvert les yeux des travailleurs du Wisconsin, de l’Ohio et de tout le pays sur la lutte de classes et la nécessité de défendre leurs droits de travailleurs et leurs droits syndicaux.
Les travailleurs du secteur privé sont aussi sous la menace. Le Parti républicain a introduit au Congrès en Juin, le projet HR 258, intitulé de façon euphémistique « Loi de protection des emplois de l’intervention du Gouvernement », qui cherche à interdire au NRLB d’empêcher la suppression ou la délocalisation d’emplois. Voyons un exemple. En 40 ans d’activités de BMW en Amérique du nord, avec des usines en Caroline du sud, les travailleurs syndiqués n’ont jamais fait la moindre grève. En 2008, l’entreprise a reçu un prêt de 3,6 milliards de $ de la Réserve fédérale, à faible taux d’intérêt, soit disant pour sauvegarder la productivité et les emplois. L’an passé, elle a réalisé 4,7 milliards de $ de profits et les dividendes des actionnaires ont augmenté de 950 millions de $. Cette année, on prévoit une augmentation de 10% de profits. Mais l’entreprise a annoncé qu’elle délocaliserait une partie de sa production en Ontario, au Canada. S’il est adopté, le HR 2587 détruira tout mécanisme contraignant la BMW à remplir ses obligations et à maintenir des emplois aux États-Unis. Selon Bill Samuel, de la confédération syndicale AFL-CIO, cette loi évidera toute l’autorité de la NLRB visant à « remettre les travailleurs à leurs postes alors que les entreprises veulent tout simplement éliminer des emplois pour supprimer des travailleurs syndicalisés, ou pour éviter de remplir leurs obligations légales à la négociation collective. »
Aux prises avec la plus longue guerre de son histoire, avec la perte de son hégémonie économique mondiale et la plus grave crise économique depuis la Grande dépression, avec une dépendance étrangère croissante en terme d’importations et de change, avec des inégalités sociales croissantes, les États-Unis se trouvent à un moment critique. Sa domination mondiale repose de plus en plus sur sa puissance militaire, ce qui est annonciateur d’immenses périls pour le monde entier. La présidence Obama a lancé des promesses d’espoirs et d’unité nationale, des promesses bien vite déçues. Les États-Unis sont encore en Afghanistan, en Irak et ils attaquent désormais la Libye, la base de Guantanamo sert encore de centre de détention, et alors que les dépenses sociales subissent des coupes, les dépenses militaires ne faiblissent pas. La crise économique a fait clairement apparaissent des fractures sociales toujours plus profondes entre les travailleurs et les plus riches ainsi que leurs serviteurs.Par André Levy, pour la revue théorique du Parti communiste portugais (PCP)
Traduction AC pour http://solidarite-internationale-pcf.over-blog.net/
Lutte de classes aux États-Unis : de la politique de classe de l’administration Obama et des gouverneurs républicains à la résistance des travailleurs du Wisconsin et de l’Ohio
Views: 1