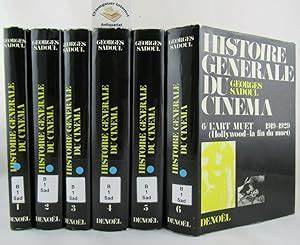Selon le vieil adage de Kissinger, nos ennemis s’en sortent quelquefois nos alliés jamais. Le cas de l’Inde devrait être médité par l’UE qui visiblement est l’allié le plus désavantagé … L’inclinaison pro-américaine de Modi a mal évalué les objectifs hégémoniques de Trump, érodant l’autonomie de l’Inde, sa position mondiale et ses intérêts à long terme. En outre à l’inverse de la Chine qui n’assume que ce à quoi elle peut réellement faire face et a préféré selon la recommandation de Deng Xiao Ping cacher sa force et attendre son heure, l’Inde de Modi a prétendu étaler une force et une autonomie qu’elle était loin de posséder à cause d’une classe dominante « néo-libérale ». Dans le fond comme lui disent les Chinois, l’Inde a trop négligé le facteur humain, celui de son propre peuple qui pourtant aujourd’hui exerce une pression qui oblige Modi à résister… encore une leçon qui concerne le peuple français (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
par Bhim Bhurtel 11 août 2025

Les relations entre l’Inde et les États-Unis sont entrées dans une phase tendue et complexe, marquée par des tensions qui remettent en question l’autonomie stratégique de l’Inde, longtemps chérie. Autrefois trop médiatisée comme un partenariat naissant d’avantages mutuels, la relation indo-américaine est aujourd’hui mise à rude épreuve par les pressions diplomatiques, les menaces économiques et l’évolution de l’ordre mondial.
La signature par l’Inde de quatre accords fondamentaux de défense avec les États-Unis – le protocole d’accord d’échange logistique (LEMOA), l’accord de compatibilité et de sécurité des communications (COMCASA), l’annexe sur la sécurité industrielle (ISA) et l’accord d’échange et de coopération de base (BECA) – l’a positionnée comme un partenaire et un allié stratégique.
Cependant, ces accords, associés à la pression commerciale croissante des États-Unis sous la présidence de Donald Trump, ont soulevé de sérieuses questions sur la capacité de l’Inde à maintenir une politique étrangère indépendante.
Cet article examine de manière critique la trajectoire des relations entre les États-Unis et l’Inde, l’approche de la carotte et du bâton des politiques de Trump, le mythe de l’autonomie stratégique de l’Inde et les défis auxquels l’Inde est confrontée dans un monde multipolaire. Il soutient que l’inclinaison pro-américaine du Premier ministre Narendra Modi a mal évalué la capacité stratégique et économique de l’Inde, mettant en péril son autonomie et sa position mondiale.
Du non-alignement à l’alignement stratégique
Pendant la guerre froide, la position non-alignée de l’Inde lui a permis d’équilibrer ses relations avec l’Union soviétique et l’Occident, en maintenant son autonomie stratégique tout en favorisant ses liens avec Moscou. L’après-guerre froide, cependant, a vu un pivot vers les États-Unis, motivé par des inquiétudes partagées concernant la montée en puissance de la Chine et les aspirations de l’Inde à devenir une puissance mondiale.
Parmi les étapes clés, citons l’accord sur le nucléaire civil entre les États-Unis et l’Inde en 2008 sous la présidence de George W. Bush, qui a légitimé le programme nucléaire de l’Inde, et le renforcement de la coopération en matière de défense sous la présidence de Barack Obama.
Au cours du premier mandat de Trump (2017-2021), les accords de partage de renseignements et les transferts de technologie de défense ont approfondi les liens, tandis que l’administration Biden a facilité les transferts de technologie des moteurs d’avions de chasse en 2023.
Ces développements, associés au rôle actif de l’Inde dans le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité (Quad) aux côtés des États-Unis, du Japon et de l’Australie, ont signalé un alignement stratégique avec Washington. Les quatre accords fondamentaux de défense, signés entre 2016 et 2020, ont été cruciaux.
LEMOA a permis un soutien logistique mutuel, COMCASA a facilité des communications sécurisées, ISA a permis des transferts de technologie et BECA a amélioré le partage de renseignements géospatiaux. Ces accords ont permis à l’Inde d’accéder à des systèmes de défense américains avancés, mais ils ont également attaché son appareil militaire et stratégique à l’orbite de Washington.
Le gouvernement Modi a présenté cela comme une étape pour contrer la Chine et élever la stature mondiale de l’Inde. Cependant, le coût de cet alignement est devenu de plus en plus évident, car il sape l’héritage des non-alignés de l’Inde et l’expose aux pressions américaines, en particulier sous le second mandat de Trump.
Le premier mandat de Trump a été caractérisé par une approche de la « carotte », attirant l’Inde par la coopération en matière de défense, les transferts de technologie et les gestes diplomatiques comme l’événement « Howdy Modi » en 2019.
Ces mesures ont été conçues pour attirer l’Inde dans le cadre indo-pacifique dirigé par les États-Unis afin de contrer la Chine. Les États-Unis ont également séduit l’Inde en promettant qu’ils encourageraient les entreprises américaines à délocaliser leur production de la Chine vers l’Inde pendant la pandémie de Covid-19, bien que des entreprises comme General Motors, Ford et Harley-Davidson aient quitté l’Inde, invoquant des défis économiques.
Malgré ces revers, le récit d’une « amitié » solide entre les États-Unis et l’Inde a été soigneusement cultivé. En revanche, le second mandat de Trump a adopté une approche « bâton », marquée par la coercition économique et diplomatique.
Trump a critiqué les achats de pétrole et d’armes de l’Inde à la Russie, menaçant d’abord de droits de douane de 25 % et maintenant de 50 % sur les produits indiens, ainsi que de sanctions supplémentaires. Cette pression découle de l’engagement continu de l’Inde avec la Russie et de son rôle dans le groupe des BRICS, que Trump perçoit comme un bloc anti-américain.
En s’appuyant sur les tarifs douaniers et les critiques publiques, Trump vise à limiter l’autonomie économique de l’Inde et à aligner ses politiques sur les intérêts américains, en particulier dans les négociations commerciales en cours avec la Chine.
Par exemple, la pression de Trump pour que l’Inde ouvre son marché agricole aux produits américains – tels que le maïs génétiquement modifié, le soja, les produits laitiers et les fruits – menace les producteurs nationaux de l’Inde. Sa demande que l’Inde cesse ses achats de pétrole russe au profit d’alternatives américaines plus chères met encore plus à rude épreuve l’économie indienne.
La rhétorique de Trump a également été humiliante. Il a qualifié l’économie indienne de « morte » pour ne pas s’être alignée sur les intérêts économiques américains et a menacé d’imposer des droits de douane de 150 à 250 % sur les exportations pharmaceutiques de l’Inde, un secteur critique.
De plus, son expulsion d’immigrants illégaux indiens par des avions militaires et son affirmation répétée de l’arrêt des frappes aériennes indo-pakistanaises dans le cadre de l’opération Sindoor en Inde ont embarrassé New Delhi. Un affront particulièrement flagrant a été le projet de Trump d’accueillir Modi aux côtés du chef de l’armée pakistanaise lors d’un dîner à la Maison Blanche, une invitation que Modi a déclinée.
Ces actions reflètent un modèle plus large d’exceptionnalisme américain, où les États-Unis cherchent à subordonner les ambitions de l’Inde à leurs intérêts hégémoniques. Ce que Modi ne parvient pas à comprendre, c’est que l’amitié avec l’Amérique est comme la plante Cuscuta (communément appelée cuscute ou amarbel en hindi) – une fois qu’elle s’enlace autour d’un arbre, elle finit par détruire son hôte.
Mythe de l’autonomie stratégique
L’Inde s’est longtemps enorgueillie d’une autonomie stratégique, enracinée dans sa politique de non-alignement et ses relations équilibrées avec les puissances mondiales. Sa participation aux BRICS et la poursuite du commerce avec la Russie et l’Iran renforcent ce récit.
Cependant, l’approfondissement du partenariat américain, notamment par le biais d’accords de défense, a érodé cette autonomie. Les États-Unis considèrent de plus en plus l’Inde comme un « État vassal » – une nation qui, bien que formellement indépendante, aligne sa politique étrangère sur celle d’une puissance dominante.
La pression exercée en 2019 par les États-Unis pour mettre fin aux importations de pétrole iranien, à laquelle l’Inde s’est conformée, et les demandes actuelles de réduction des achats de pétrole russe mettent en évidence cette dynamique. La conformité de l’Inde risque de la transformer en un partenaire subordonné, ce qui compromettrait ses aspirations multipolaires.
L’inclinaison pro-occidentale de Modi a exacerbé cette vulnérabilité. En privilégiant les liens avec les États-Unis plutôt que les partenariats régionaux tels que l’initiative chinoise Belt and Road (BRI) ou le bloc commercial du Partenariat économique régional global (RCEP), l’Inde s’est isolée des cadres économiques alternatifs.
Le conflit de 2020 dans la vallée de Galwan avec la Chine, qui a fortement tendu les relations entre l’Inde et la Chine, était une erreur stratégique. La décision de Modi d’abandonner les accords conclus lors des sommets en 2018 de Wuhan et en 2019 de Mahabalipuramavec la Chine, associée au retrait de l’Inde du RCEP, reflète une dépendance excessive vis-à-vis des États-Unis.
Cela a laissé l’Inde dans une situation économique vulnérable, en particulier avec la menace des droits de douane américains et l’augmentation des déficits commerciaux.
Les erreurs stratégiques commises par l’Inde sous la direction de Modi sont flagrantes. Bien qu’elle soit la cinquième économie mondiale, avec un PIB d’environ 3 500 milliards de dollars américains en 2025, l’Inde n’a pas le poids économique et militaire des États-Unis ou de la Chine.
Le gouvernement Modi avait prévu que l’Inde deviendrait une économie de 10 000 milliards de dollars d’ici 2025, capable de rivaliser avec la Chine, mais la croissance économique n’a pas été à la hauteur. Contrairement à la Chine, qui a adopté une stratégie consistant à « cacher sa force et attendre son heure » jusqu’à ce que son économie dépasse les 10 000 milliards de dollars, l’Inde s’est prématurément positionnée comme une puissance mondiale.
Cette arrogance a attiré l’attention des États-Unis, car les puissances montantes qui défient l’hégémonie sont rarement tolérées. L’orientation pro-occidentale de Modi a été en partie alimentée par les médias et les dirigeants occidentaux qui l’ont salué comme un homme d’État mondial, un discours destiné à attirer l’Inde dans l’ordre mondial dirigé par les États-Unis.
La position stratégique de l’Inde dans l’océan Indien et sa population de 1,4 milliard d’habitants en faisaient un partenaire intéressant pour contrer la Chine. Cependant, cette flatterie masquait les risques liés à un alignement trop étroit avec les États-Unis.
Le rejet par Modi de la BRI et du RCEP, motivé par les craintes de la domination économique chinoise, s’est retourné contre lui. Le déficit commercial de l’Inde avec la Chine a explosé, et son absence dans ces cadres a limité son influence régionale.
Pendant ce temps, les États-Unis ont exploité l’alignement de l’Inde sans offrir d’avantages réciproques, comme en témoignent le retrait des entreprises américaines et l’escalade des droits de douane.
Au cœur des tensions entre les États-Unis et l’Inde se trouve l’exceptionnalisme américain – la croyance que les États-Unis sont la puissance mondiale prééminente chargée de faire respecter leur soi-disant ordre fondé sur des règles. La politique « America First » de Trump amplifie cela, donnant la priorité aux intérêts économiques et stratégiques des États-Unis plutôt qu’aux aspirations des alliés.
Le sens de l’exceptionnalisme de l’Inde, enraciné dans sa civilisation ancienne et son statut de puissance émergente, se heurte à ce cadre sur la scène mondiale. La poursuite par l’Inde d’un monde multipolaire, par le biais des BRICS et des liens avec la Russie et l’Iran, défie l’hégémonie américaine, ce qui en fait une cible de coercition.
L’adage d’Henry Kissinger – « Il peut être dangereux d’être l’ennemi de l’Amérique, mais être l’ami de l’Amérique est fatal » – sonne particulièrement vrai pour l’Inde. Les États-Unis cherchent à limiter l’autonomie de l’Inde, en s’assurant qu’elle reste un partenaire subordonné plutôt qu’une puissance indépendante.
Les pressions de Trump – sur le commerce, les achats de pétrole et les marchés agricoles – sont conçues pour aligner les politiques de l’Inde sur les intérêts américains, même au prix de la souveraineté économique et stratégique de l’Inde.
Défis et options
L’Inde est confrontée à un avenir précaire avec des options limitées, chacune comportant de nombreux risques. La première est de maintenir le statu quo, en subissant les insultes et les pressions américaines tout en espérant un changement de leadership américain après 2028.
Cependant, il est peu probable que même une administration démocrate s’écarte de manière significative de l’approche hégémonique actuelle, laissant l’Inde vulnérable à la coercition américaine continue.
Par exemple, en avril 2021, moins de 100 jours après l’entrée de Biden à la Maison Blanche, l’USS John Paul Jones de l’US Navy a mené une opération de liberté de navigation (FONOP) près des îles Lakshadweep, à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l’Inde, affirmant ses droits et libertés de navigation dans une décision largement considérée comme une violation de la souveraineté de l’Inde.
La deuxième option consiste à diversifier les partenariats avec la Russie, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les économies de marché émergentes afin de renforcer l’autonomie stratégique. Cela nécessite des réformes économiques pour stimuler la consommation intérieure et remplacer le commerce américain par des marchés alternatifs.
Cependant, cette voie risque d’entraîner des pertes économiques à court terme et exige des changements de politique audacieux, que le gouvernement Modi a été réticent à poursuivre. Montek Singh Ahluwalia, qui a été vice-président de la Commission de planification de l’Inde sous le Premier ministre Manmohan Singh, a souvent souligné les défis politiques liés à la mise en œuvre de réformes économiques audacieuses en Inde.
L’une de ses observations notables était qu’« il existe un fort consensus en Inde pour des réformes économiques faibles », ce qui reflète l’approche prudente et progressive souvent adoptée en raison de la résistance politique et sociale à des changements plus radicaux. Modi ne peut donc pas entreprendre des réformes radicales immédiatement.
La troisième option consiste à accepter les droits de douane américains à court terme tout en investissant dans les capacités militaires et économiques pour réduire la dépendance au fil du temps. Cela nécessite une planification à long terme et une résilience, ce que les contraintes économiques actuelles de l’Inde peuvent ne pas soutenir.
Une quatrième option, plus radicale, consiste à se tourner vers des cadres régionaux tels que la BRI et le RCEP, en approfondissant les liens avec la Chine et les pays du Sud. Pour ce faire, il faudrait surmonter la résistance politique intérieure et résoudre les problèmes de sécurité avec la Chine, une perspective difficile compte tenu de la confrontation armée de Galwan en 2020. Cependant, une telle décision pourrait améliorer les perspectives économiques et l’influence régionale de l’Inde, en tirant parti de sa position stratégique dans l’océan Indien.
Enfin, une option théorique mais peu plausible est de mener une guerre commerciale avec les États-Unis, à l’instar de l’approche de la Chine. L’Inde ne dispose pas des ressources stratégiques, de la technologie et de la puissance économique nécessaires pour soutenir une telle guerre commerciale, ce qui la rend irréalisable. Au lieu de cela, l’Inde doit adopter une approche pragmatique, en tirant les leçons de la stratégie de la Chine de force et de timing stratégique discrets.
En somme, la relation entre les États-Unis et l’Inde, autrefois saluée comme un partenariat stratégique, s’est transformée en un jeu complexe de coercition et de dépendance. L’approche de la carotte et du bâton de Trump – séduisant l’Inde en ouvrant l’économie américaine, en la défense et les transferts de technologie au cours du premier mandat et en imposant des pressions économiques et diplomatiques au cours du second mandat – a révélé la fragilité de l’autonomie stratégique de l’Inde.
La politique pro-occidentale de Modi, motivée par une surestimation des capacités de l’Inde et une sous-estimation des ambitions hégémoniques américaines, a placé l’Inde dans une position vulnérable. Pour traverser cette crise, l’Inde doit recalibrer sa politique étrangère, en équilibrant ses relations avec les États-Unis, la Chine, la Russie et d’autres puissances régionales, tout en accélérant les réformes économiques intérieures.
Ne pas le faire risque de réduire l’Inde à un État vassal, sapant ainsi ses aspirations à devenir une puissance mondiale indépendante. La voie à suivre exige de la finesse diplomatique, de la résilience économique et une réévaluation sobre de la place de l’Inde dans un monde multipolaire.
Bhim Bhurtel
Bhim Bhurtel enseigne l’économie du développement et l’économie politique mondiale dans le cadre du programme de maîtrise de l’Université ouverte du Népal. Elle a été directeur exécutif du Nepal South Asia Center (2009-14), un groupe de réflexion sur le développement de l’Asie du Sud basé à Katmandou. Bhurtel est joignable à l’adresse suivante bhim.bhurtel@gmail.com.
Views: 53