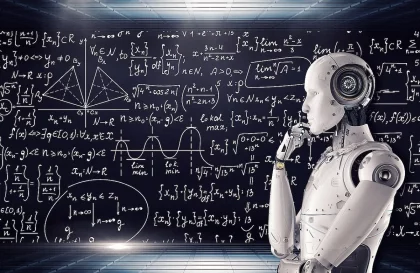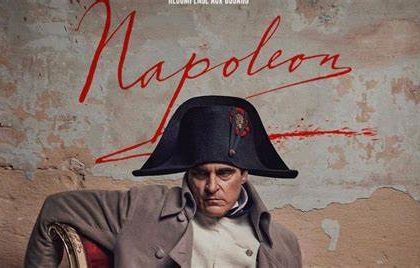ce texte, qui ne remet en question aucun des pressuposés occidentaux sur la « dictature chinoise » et le caractère supposé injuste de sa revendication taiwanaise appartenant à une seule Chine pourtant internationalement reconnue y compris par les Etats-Unis, dit à sa manière le peu de crédit que l’on peut accorder à la prétention occidentale à gérer le monde et cela ne s’améliore pas. Certes il transforme le bellicisme des Etats-Unis en une sorte de casse tête destiné à rendre fous les présidents des Etats-Unis et comme Trump l’est déjà le pire est prévisible. Ce point de vue rend d’autant plus révélateur la manière dont l’auteur s’inquiète de la stratégie occidentale, US et vassaux visant à transformer l’Asie en poudrière. L’article sur un mode ironique s’interroge particulièrement sur la volonté non seulement d’accumuler des armes, mais de changer la culture pacifiste des Japonais en les transformant en féroces guerriers, le modèle étant le peuple israélien (un exemple qui n’est pas peut-être le mieux choisi s’inquiète ce juif new yorkais spécialiste de Spinoza). Son analyse a au moins le mérite, comme souvent celle de The New yorker; le mérite de nous arracher le sourire du week end du 14 juillet , notre fête nationale avec en tête d’affiche Macron à la tête des armées… Que peut-on imaginer de plus grotesque ? J’ai décidé de boycotter cette vision de notre déclin en allant voir la première partie du Napoléon d’Abel Gance, trois heures le dimanche 14 juillet et je remet ça pour la suite en deux heures mardi 16 juillet. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoireetsociete).
« L’œuvre d’art », « Les autres olympiens », « La route côtière » et « Colocataires ».Par Ian Buruma24 juin 2024

La question de Taïwan est lourde de mauvaises histoires, ce qui brouille notre compréhension de ce qui est en jeu en Asie de l’Est.Illustration par Álvaro Bernis
Des guerres catastrophiques peuvent commencer dans des endroits périphériques : Sarajevo, pour la Première Guerre mondiale ; Gleiwitz, à la frontière germano-polonaise, pour le second. Les contributeurs de « The Boiling Moat » (Hoover Institution), un court livre édité par Matt Pottinger, pensent que Taïwan, l’île gouvernée démocratiquement située au large des côtes du sud-est de la Chine entre le Japon et les Philippines, pourrait déclencher une guerre majeure, peut-être même nucléaire, opposant les États-Unis et leurs alliés asiatiques à la Chine. Selon leurs estimations, plus de dix mille Américains pourraient être tués au combat en seulement trois semaines de combat. Le coût en vies chinoises et taïwanaises, civiles et militaires, serait probablement beaucoup plus élevé. Et cela suppose qu’une guerre locale ne s’étende pas au reste du monde. Pottinger était le directeur de l’Asie au Conseil de sécurité nationale sous Donald Trump, et ses opinions méritent donc qu’on s’y attarde.
Cela ne veut pas dire que les opinions bellicistes de Pottinger sur la nécessité d’une intervention américaine en Asie de l’Est lui vaudraient une place dans une deuxième administration Trump. L’isolationnisme maga a toujours été en tension avec la rhétorique dure de l’ancien président envers la Chine, qui, à son tour, est en tension avec son penchant pour conclure des accords avec les dictateurs. Les contributeurs de « The Boiling Moat » ne sont pas non plus du type maga ; ce sont un mélange de prodiges militaires, dont un amiral japonais et un ancien sous-traitant du Commandement des opérations spéciales des États-Unis, et de faucons pour la démocratie, comme Anders Fogh Rasmussen, l’ancien secrétaire général de l’otan.
Il y a en effet de bonnes raisons de s’inquiéter d’un conflit en Asie de l’Est. Contrairement aux précédents dirigeants chinois, qui se contentaient, dans l’ensemble, de laisser la question de Taïwan en suspens jusqu’à ce qu’une sorte de résolution pacifique puisse être trouvée, Xi Jinping a avoué que « l’unification de la patrie » est « l’essence » de sa campagne pour « rajeunir la nation chinoise », et a indiqué qu’il était prêt à utiliser la force militaire pour y parvenir. Après que Lai Ching-te, le président taïwanais nouvellement élu, ait déclaré dans son discours d’investiture que la République de Chine (le nom officiel de Taïwan) et la République populaire de Chine « ne sont pas subordonnées l’une à l’autre », le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, a accusé Lai et ses partisans de trahir la Chine et leurs « ancêtres ». Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a utilisé des mots encore plus pugnaces. Quiconque aspire à l’indépendance de Taïwan, a-t-il dit, sera « écrasé en morceaux ».
Si une tentative chinoise de prendre Taïwan par la force réussissait, les conséquences pourraient être désastreuses. Les pays d’Asie de l’Est, paniqués par le contrôle de la Chine sur leurs routes d’approvisionnement en mer de Chine orientale et par la réticence ou l’incapacité des États-Unis à les protéger, pourraient se lancer dans une course aux armements nucléaires. L’industrie taïwanaise des semi-conducteurs, qui fournit au monde plus de la moitié de ses puces, tomberait entre les mains des Chinois. Et, parce que Taïwan est aussi la seule démocratie libérale fonctionnelle dans le monde sinophone (Singapour est une démocratie illibérale), écraser le système de gouvernement de Taïwan serait un coup dur pour les démocrates, plus grand encore que la répression à Hong Kong.
Pottinger et ses collaborateurs pensent que la seule façon d’empêcher la Chine de lancer une attaque contre Taïwan, et éventuellement de déclencher une guerre dévastatrice, est de construire un système de dissuasion militaire si formidable que la Chine n’oserait pas l’affronter . Leur livre est une sorte de briefing PowerPoint sur la façon de transformer le détroit de Taïwan en un « fossé bouillant » rempli de jassm(missiles air-sol conjoints), de lrasm(missiles antinavires à longue portée), de himars (systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité), de P.J.D.A.M. (munitions d’attaque directe conjointes motorisées), de drones maritimes sans équipage et de beaucoup d’autres matériels et logiciels militaires. Les lecteurs auront besoin d’un goût pour la prose militaire dense pour se mettre au diapason de phrases telles que « Si les opérateurs de niveau tactique ont des tirs organiques de r.i. [renseignement, surveillance et reconnaissance] et une autorité d’engagement, ils peuvent identifier et attaquer les forces ennemies à courte portée qui répondent à certains profils prédéterminés (par exemple, les forces de débarquement). »
Les missiles, les drones et les bombardiers sont toutefois insuffisants pour dissuader la Chine, selon les auteurs du livre. Taïwan et le Japon doivent être dotés d’une « nouvelle culture militaire ». Grant Newsham, un ancien marine qui a servi comme attaché du Corps des Marines à Tokyo, pense que le peuple japonais doit être préparé « physiquement et psychologiquement » à une guerre à propos de Taïwan. Il mentionne des films qui pourraient « augmenter le moral (l’effet Top Gun) ». Pottinger présente les Israéliens comme un modèle : « Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, les avantages de l’éthique guerrière d’Israël ont été à nouveau exposés alors que les Israéliens se sont unis, malgré d’amères différences politiques intérieures, pour mener une guerre pour détruire le Hamas. » (Ce n’est peut-être pas l’exemple le plus heureusement choisi.) Et dire aux Japonais de redevenir une nation de guerriers reviendrait à pousser à un renversement complet de la nature irénique du Japon d’après-guerre et de la constitution pacifiste écrite par les Américains en 1947.
On peut convenir que Taïwan mérite d’être défendue contre une agression militaire, mais ce qui manque dans tout ce discours sur les missiles, les drones et l’esprit combatif, c’est tout sens de la politique ou de l’histoire. Les références au passé dans « Les douves bouillantes » ne sont que des plus grossières : Xi Jinping est comparé à Hitler ; l’Armée populaire de libération est appelée « Wehrmacht chinoise » ; et l’exemple inévitable de l’apaisement de Chamberlain envers Hitler, en 1938, est invoqué comme un avertissement contre la complaisance.
La politique, elle aussi, est réduite à des slogans sur la défense de la démocratie dans des « partenariats contre-autoritaires ». Dans le dernier chapitre, les deux contributeurs européens du livre écrivent : « Vous ne pouvez pas vous déclarer neutre lorsqu’il s’agit de la ligne de front de la liberté – dans le Donbass ou dans le détroit de Taïwan. » Ce sont de belles paroles de combat, faisant écho à une déclaration de l’ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen : « Le cri de ralliement de toutes les démocraties doit être un pour tous, et tous pour un. »
On peut l’entendre prononcer ces mots dans « Invisible Nation », un documentaire de Vanessa Hope, qui présente un cas simple de défense de la démocratie taïwanaise. Le film offre une courte histoire, opposant les admirables Taïwanais (et Américains) aux menaçants Chinois. Cette approche n’est pas tout à fait fausse, mais « Invisible Nation » a l’air d’un film de campagne pour le Parti démocrate progressiste indépendantiste, maintenant au pouvoir à Taïwan.
L’histoire, bien sûr, n’est jamais simple. Le souci de la démocratie et de la liberté n’a pas toujours été la raison de défendre Taïwan. Le président Eisenhower est au bord de la guerre nucléaire avec la Chine en 1954, après que Mao a attaqué Quemoy (Kinmen) et Matsu, deux îles minuscules au large du continent qui appartenaient officiellement à la République de Chine, alors qu’elle était sous la dictature militaire brutale du généralissime Chiang Kai-shek.
La question de Taïwan est, en fait, lourde de mauvaises histoires, ce qui brouille notre compréhension de ce qui est en jeu en Asie de l’Est. Comme l’observe Sulmaan Wasif Khan dans son livre riche et réfléchi « The Struggle for Taiwan » (Basic), un « historien observant la situation de loin ne pouvait s’empêcher d’être frappé par l’étrange mélange de mensonges, d’amnésie et de demi-vérités exposées ». Commençons par l’affirmation de la Chine selon laquelle Taïwan a toujours fait partie de la Chine, une pierre angulaire du nationalisme de Xi. En fait, pendant la majeure partie de son histoire, Taïwan, ou Formose, comme on l’appelait autrefois, ne faisait pas plus partie de la nation chinoise que, disons, Gibraltar ne faisait partie de la Grande-Bretagne. Jusqu’au XVIIe siècle, lorsque les Hollandais ont gouverné l’île en tant que colonie, pratiquement aucun Chinois n’y vivait. Les habitants d’origine, dont les descendants constituent aujourd’hui une petite minorité à Taïwan, étaient des tribus austronésiennes qui se régnaient dans un certain nombre de chefferies. Ensuite, les Hollandais ont fait venir des dizaines de milliers de personnes de Chine pour cultiver la terre. En 1662, les Hollandais ont été évincés par un bretteur mi-japonais, mi-chinois nommé Zheng Chenggong, également connu sous le nom de Koxinga, dont les exploits sont toujours célébrés dans une célèbre pièce de Kabuki. Koxinga était un fidèle de la dynastie Ming déchue. Il espérait organiser une rébellion de Taïwan contre les dirigeants Qing, qui n’étaient pas chinois mais mandchous. Koxinga a brièvement établi un royaume indépendant sur l’île, mais elle a été renversée par les Mandchous en 1683. Taïwan est ensuite devenu une partie de l’empire Qing.
Après que les Qing aient perdu une guerre avec le Japon, en 1895, Taïwan est devenue une colonie japonaise. Pour démontrer aux nations occidentales que le Japon pouvait également être une grande puissance impériale, les Japonais ont présenté Taïwan comme une colonie modèle : plus moderne, plus industrialisée, plus avancée technologiquement que n’importe quelle partie de l’empire Qing. Une partie de la grande architecture Belle Époque de la période coloniale japonaise – bâtiments gouvernementaux, tribunaux, universités, musées – peut encore être vue à Taipei et dans d’autres villes.
Lorsque l’empire asiatique du Japon a été dissous, en 1945, le sort de Taïwan est resté ouvert. Le président Roosevelt, lors de la conférence du Caire de 1943, avait promis de remettre Taïwan à Tchang Kaï-chek, qui dirigeait des parties de la Chine qui n’étaient pas occupées par les Japonais. Pourtant, Roosevelt aurait pu faire un choix différent. Pas plus tard qu’en juillet 1949, quelques mois seulement avant la défaite des nationalistes de Tchang (ChiNats) dans la guerre civile avec les communistes de Mao Zedong (ChiComs), George Kennan préconisait « l’établissement d’un régime international provisoire ou américain qui invoquerait le principe de l’autodétermination des insulaires ». Cette perspective, si elle a jamais vraiment existé, a pris fin lorsque le généralissime (« le Gimo », pour les Américains) s’est retiré à Taïwan après la victoire communiste, avec plus d’un million de ses soldats et de ses loyalistes. Lorsque j’ai voyagé pour la première fois à Taïwan, dans les années 1980, de nombreux chauffeurs de taxi à Taipei avaient été des soldats de l’armée de Chiang. Il y avait des statues du Gimo devant les écoles et les bâtiments publics ; les cartes de la Chine illustraient l’objectif officiel de reconquérir le continent.
Mao n’a pas prêté beaucoup d’attention à Taïwan jusqu’à ce que Chiang en fasse une base fortifiée pour son rêve de régner à nouveau sur la Chine. Pendant ce temps, les six millions d’habitants d’origine de Taïwan, dont la plupart n’étaient jamais allés en Chine, n’ont pas apprécié d’être soumis à la dure junte militaire de Tchang. Une rébellion en février 1947 a entraîné la mort d’environ vingt-cinq mille Taïwanais et des années de répression, connue sous le nom de « terreur blanche », qui a conduit à l’emprisonnement de dizaines de milliers de personnes et à la mort de milliers d’autres.
La décision du président Eisenhower de venir à la rescousse de Tchang dans les années 1950, lorsque Mao a commencé à bombarder Matsu et Quemoy, n’avait rien à voir avec la défense de la démocratie (même si la République de Chine était toujours connue sous le nom de Chine libre) et tout à voir avec le durcissement du communisme. C’était plus une attitude qu’une politique bien pensée, et Tchang, comme beaucoup d’autres hommes forts anticommunistes dans le monde, savait comment l’exploiter afin d’obtenir ce qu’il voulait des Américains.
Les tensions entre les « Taïwanais de souche », ou benshengren, dont la plupart étaient d’origine chinoise, et les continentaux de Chiang, ou waishengren, qui les dominaient, ont continué à couver pendant des décennies. Les rebelles politiques et les dissidents étaient presque toujours des benshengren. Dans le même temps, le rêve de Tchang de renverser les « bandits communistes » en Chine ne s’est jamais estompé. Je me souviens avoir vu des vieillards en fauteuil roulant être poussés dans les couloirs du bâtiment du parlement à Taipei, agissant comme les représentants officiels des provinces chinoises qu’ils ne reverraient jamais.
Tchang était encore en vie lorsque, en 1972, Richard Nixon et Henry Kissinger ont rencontré le Premier ministre chinois, Zhou Enlai, puis ont signé un communiqué à Shanghai déclarant qu’il n’y avait qu’une seule Chine et que Taïwan en faisait partie. Cela en soi n’aurait pas dérangé Tchang (qui mourut trois ans plus tard) ; il était lui aussi d’accord avec l’idée qu’il n’y avait qu’une seule Chine. On ne parlerait plus de ChiNats et de ChiCom ; ils étaient tous chinois maintenant. Les personnes qui n’étaient pas d’accord étaient des dissidents benshengren qui aspiraient à l’indépendance. Cette aspiration ne convenait pas à Zhou, à Tchang ou, en fait, à Kissinger. Comme l’écrit Khan, « le sort de Taïwan n’avait pas d’importance pour Kissinger. Il s’agissait d’un rapprochement avec la Chine. La suppression du mouvement indépendantiste de Taïwan, a convenu Zhou, pourrait être laissée à Tchang Kaï-chek. Le généralissime tant décrié aiderait la RPC en s’assurant que l’indépendance de Taïwan ne progresse pas.
Au cours des années 1980 – un modus vivendi avec la Chine ayant été atteint et Deng Xiaoping ouvrant le pays aux affaires – durcir le communisme a reculé en tant que priorité pour Washington. Autrefois utiles, les hommes forts anticommunistes sont devenus superflus. En 1986, Ferdinand Marcos a été contraint à l’exil à Hawaï. La junte sud-coréenne a été pressée d’accepter des élections démocratiques en 1987. Et le président Chiang Ching-kuo, le fils du généralissime, a mis fin à la loi martiale la même année. Il a même permis à un nouveau parti d’opposition, le Parti démocrate progressiste, de participer aux élections.
Le premier président démocratiquement élu de Taïwan, Lee Teng-hui, n’était pas membre du PDP mais du parti nationaliste de Tchang, le Kuomintang (le K.M.T.). Il était cependant né dans le pays et parlait le taïwanais (chinois Hokkien), la langue parlée par la plupart de ses compatriotes, et il était plus à l’aise avec le japonais, héritage de son éducation coloniale, qu’avec le mandarin. Lee a donné une nouvelle tournure à l’objectif officiel d’unification : Taïwan rejoindrait la Chine, oui, mais seulement une fois que la Chine serait devenue une démocratie. Il se considérait également comme une figure unificatrice à Taïwan, le leader qui surmonterait les tensions entre les autochtones et les intrus du continent.
On aurait pu supposer que les États-Unis, qui se sont présentés comme un champion de la liberté et de la démocratie, auraient été ravis de cette tournure des événements. En fait, cela a compliqué la politique américaine envers la Chine. Maintenant que les Taïwanais pouvaient librement exprimer leurs opinions et voter, il est devenu clair que peu de gens en dehors des factions conservatrices du K.M.T. avaient le moindre désir de faire partie de la Chine continentale. La démocratie taïwanaise a promu une identité nationale taïwanaise distincte de la Chine continentale. (J’ai assisté à des rassemblements pour le DPP de Tsai Ing-wen lors des élections de 2020, lorsque des foules immenses scandaient : « Nous sommes Taïwanais ! Nous sommes taïwanais ! »)
Cette identité était culturelle et historique aussi bien que politique. La langue taïwanaise était désormais enseignée dans les écoles, tout comme l’histoire taïwanaise. Les écrivains et artistes taïwanais, un peu comme les nationalistes catalans en Espagne, ont mis l’accent sur les valeurs uniques de leurs arts et de leur culture d’origine, parfois à un degré fatigant. Il y a eu un boom des films sur l’histoire taïwanaise et les particularités de la vie taïwanaise. De plus en plus, les citoyens ont commencé à s’identifier comme Taïwanais plutôt que comme Chinois. Les politiciens du DPP se sont présentés aux élections en vantant leurs références taïwanaises. Et même les jeunes politiciens du K.M.T., qui n’a jamais officiellement abandonné son identification avec la Chine, sont à l’aise pour parler taïwanais. Au moment où Chen Shui-bian a été élu premier président du DPP de Taïwan, en 2000, les bustes de Tchang Kaï-chek et les cartes de la Chine avaient commencé à disparaître. Pendant ce temps, la Chine devenait le plus grand partenaire commercial de Taïwan, ce qui rendait encore plus confuses leurs relations.
Du point de vue de Washington, la démocratie taïwanaise est devenue une sorte d’irritant. Tchang Kaï-chek, bien qu’entêté et manipulateur, avait été plus facile à traiter que les politiciens démocratiquement élus dont le flirt avec l’idée d’indépendance provoquait des réactions chinoises belliqueuses et compliquait les relations entre les États-Unis et la Chine. Washington a estimé qu’il devait à la fois défendre Taïwan démocratique et rassurer Pékin sur le fait que l’indépendance de Taïwan continuerait à être combattue. Cela « a rendu l’Amérique folle », écrit Khan. Washington « affirmerait le principe d’une seule Chine, puis se tordrait en expliquant comment son inclinaison vers Taïwan était cohérente avec cette affirmation ». Un président Clinton frustré s’est exclamé un jour : « Je déteste notre politique chinoise ! J’aimerais me présenter contre notre politique chinoise. » Comme l’observe Khan, « D’une certaine manière, lui et tous les présidents depuis Nixon ont fait exactement cela. »
Essayer de garder Pékin de son côté en affirmant que Taïwan fait partie de la Chine tout en défendant un gouvernement démocratiquement élu qui pense le contraire ne constitue pas une politique cohérente. Les États-Unis n’auraient pas non plus l’obligation de défendre Taïwan si la Chine l’envahissait réellement. La position officielle est toujours de laisser les Chinois deviner la réponse américaine. Pourtant, le président Biden a déclaré, dans une interview télévisée de 2021 avec George Stephanopoulos, que les États-Unis viendraient effectivement à la rescousse de Taïwan en cas de guerre, de la même manière qu’ils le feraient si le Japon ou un membre de l’otan était attaqué.
Biden n’aurait probablement pas dit cela si la Chine elle-même n’avait pas radicalement changé au cours de la dernière décennie. Sous les dirigeants relativement pragmatiques de la Chine dans les années 1990, les chances d’un conflit militaire à propos de Taïwan étaient minces. Mais le nationalisme hostile de Xi, visant à une restauration complète des frontières de l’empire Qing, par la force si nécessaire, est une plus grande menace pour le statu quo que ne l’était le bombardement de Matsu et Quemoy par Mao. Alors que Taïwan pourrait encore être traité comme une gêne par Kissinger et Nixon, ou même par Clinton, les États-Unis se sentent maintenant obligés de montrer qu’ils peuvent être durs avec la Chine et risquer la guerre pour défendre Taïwan. Ce n’est, bien sûr, pas plus une position mûrement réfléchie que ne l’était « l’anticommunisme ». Lorsque d’éminents politiciens américains provoquent Pékin avec des visites très médiatisées à Taïwan, leur seul but est de montrer au public américain qu’ils peuvent être durs avec la Chine.
Une fois de plus, Taïwan est devenu un pion dans un affrontement entre grandes puissances. Les enjeux sont plus élevés que jamais. Mais protéger l’Asie de l’Est d’une guerre terrible n’est pas seulement un problème militaire. Khan a certainement raison de se demander comment le durcissement modifiera la conduite chinoise. Une démonstration de force est censée dissuader la Chine d’agresser. « Mais que se passerait-il si la dissuasion échouait ? » Khan écrit. « Être dissuadé, après tout, était un choix ; La Chine pourrait choisir de ne pas l’être. Et si la démonstration de force poussait la Chine dans un coin d’où elle sentait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de se déchaîner ?
Éviter un conflit violent demandera beaucoup de finesse diplomatique, guidée par une connaissance approfondie de l’histoire et de la politique locales. On se demande donc qui Pottinger essaie de convaincre. Son public cible principal est-il taïwanais, japonais ou américain ? Il mentionne, comme un obstacle à la dissuasion, « l’isolationnisme des années 1930 qui a infecté des poches du discours politique en Amérique et en Europe ». On ne peut que supposer que cela vise son ancien patron de la Maison Blanche.
La presse japonaise parle maintenant beaucoup de la question de moshitora – moshi signifie « si », et tora est l’abréviation de Torampu (Trump). Et si Trump revenait ? Les attitudes de l’ex-président envers la Chine sont encore moins cohérentes que celles de ses prédécesseurs. Il s’est plu à insulter la Chine (« virus chinois », « grippe Kung ») ; il a également déclenché une guerre commerciale avec la Chine et a promis d’imposer des droits de douane de 60 % sur toutes les importations chinoises. Mais son retrait, en 2017, du Partenariat transpacifique, qui fixe les règles du commerce dans la région du Pacifique, a affaibli l’influence de l’Amérique dans la région et renforcé celle de la Chine.
Si les anciennes politiques américaines à l’égard de Taïwan ont souvent été confuses, les attitudes de Trump sont si inconstantes qu’on ne peut pas prédire ce qu’il fera. « Selon son humeur, écrit Khan, il aurait pu être aussi disposé à fournir à Taïwan des armes nucléaires qu’à les vendre à la Chine pour un accord commercial. » Avec un président comme celui-ci aux commandes, aucune quantité de jassmet de himar n’est susceptible d’assurer la sécurité de l’Asie de l’Est, ou, en fait, du reste du monde. ♦Publié dans l’édition imprimée du numéro du 1er juillet 2024, sous le titre « The Taiwan Tangle ».
- Le tueur qui est entré à Harvard.
- Un voleur qui n’a volé que de l’argent.
- La lumière de la première bombe nucléaire au monde.
- Comment Steve Martin a appris ce qui est drôle.
- Grandir en tant que fils du lion lâche.
- Le dernier vol d’Amelia Earhart.
- Fiction de Milan Kundera : « L’insoutenable légèreté de l’être ».
Ian Buruma, professeur au Bard College, est l’auteur de livres tels que « Spinoza : Freedom’s Messiah ».
Views: 2