Richard Brody qui écrit dans The Newyorker est un des critiques de cinéma que je ne rate jamais… Il est le plus français des chroniqueurs américain, et à ce titre il sait nous dire à quel point nous nous enfonçons, nous Français dans le lieux communs, le politiquement correct, tous les clichés soiétaux de la littérature d’aéroport (un succedanné pour bobos nomades et festivaliers de la littérature de gare). Et là il met le doigt sur le rôle joué par certains films et cinéastes, non pas les plus grands mais ceux qui libèrent le regard d’une époque, citzien Kane permet vertigo, et à bout de souffle nous fait découvrir la rue, et autre usage des lavabos d’hôtel… On ne comprend rien au cinéma si on y pense avec nostalgie, non c’est toujours pour moi l’exigence d’un film qui nous dirait enfin ces temps nouveaux déjà là., l’apprentissage de la liberté, du refus de tous les clichés… (noteet traduction de danielle Bleitrach)
Par Richard Brody4 septembre 2012

Àpartir d’aujourd’hui, le Film Forum accueille l’équivalent cinéphilique de la bataille des mastodontes. Cette année, « Vertigo » a été nommé meilleur film de tous les temps dans le sondage des critiques de Sight & Sound, prenant le titre de « Citizen Kane » (qui l’avait détenu dans toutes les éditions précédentes du sondage depuis 1962), et le cinéma propose une semaine de diffusion du premier long métrage détrôné d’Orson Welles (j’en ai une critique capsule dans le magazine). suivi d’une semaine dans le labyrinthe de la fin de carrière d’Hitchcock.
La question est inévitable : pourquoi ce changement ? Pourtant, d’une certaine manière, la réponse est évidente : « Citizen Kane » n’est même pas le meilleur film de Welles, et ne peut donc pas être le meilleur film de tous les temps. Mais pourquoi a-t-il conservé le titre si longtemps ? La réponse à cette question est tout aussi simple : parce que c’était le film le plus libérateur de tous les temps, il n’y aurait pas eu de « Vertigo » sans « Kane ». Alfred Hitchcock, déjà en milieu de carrière (il est né en 1899), n’était que l’un des nombreux réalisateurs établis qui, après la guerre, se sont lâchés avec des envolées de mise en scène plus folles. Et si la fin de la guerre a été en partie responsable de ces nouvelles libertés (tout comme l’a été la montée en puissance des producteurs indépendants en raison de l’affaiblissement des studios par des poursuites antitrust), le film de Welles a été le premier à offrir aux réalisateurs un excellent exemple de ce à quoi ces libertés pouvaient servir à l’ère des films sonores. La manière désinhibée de Welles avec la bande-son (en raison de son expérience de la radio) lui a permis de libérer des images – puisqu’il était capable de cadrer l’histoire avec le son seul, il a mis à l’écran une sorte de « piste d’image » distincte et diversifiée, utilisant la caméra pour provoquer l’émotion avec une extase esthétique primitive proche de celle de la musique. Sa célèbre technique de « mise au point profonde » n’était pas tout à fait originale, mais son utilisation l’était – il n’unifiait pas tant l’espace dramatique qu’il ne le pliait ; Ses décors et ses éclairages étaient moins une question d’adéquation que d’ornementation. Welles a joué l’équivalent visuel de la libération de l’orchestre de la fosse, pour jouer des symphonies.
Les électeurs du scrutin de 1952 auraient encore été sous le choc de l’onde de choc de la sortie de « Kane ». Aujourd’hui, son véritable concurrent vient d’un autre film, tout aussi libérateur, « À bout de souffle » (qui n’a été que treizième sur la nouvelle liste, et pour la même raison : ce n’est pas le meilleur de Jean-Luc Godard, mais sa grandeur est, dans une large mesure, dans ce qu’il a suscité). Pas de « Kane », pas de « Vertigo » ; mais pas de « Breathless », pas de reconnaissance généralisée de « Vertigo ». La grandeur d’Hitchcock a d’abord été reconnue et définie par les critiques qui sont devenus les réalisateurs de la Nouvelle Vague, et leurs films sont ce qui a finalement confirmé l’importance de leur découverte – d’Hitchcock ainsi que d’autres auteurs hollywoodiens, y compris Welles. C’est Welles qui leur a fait penser au cinéma comme à l’art d’une jeunesse – ils aspiraient, comme lui, à faire leurs premiers longs métrages à l’âge de vingt-cinq ans. (François Truffaut a fait son premier, « Les 400 coups », à vingt-six ans.) En célébrant « Vertigo » comme le plus grand film de tous les temps, les critiques de cinéma ne répudient pas « Kane » mais extrapolent plutôt à partir de celui-ci, ratifiant la Nouvelle Vague française comme la révolution cruciale dans l’histoire du cinéma.
Bien sûr, Welles a été attaqué dans les pages de ce magazine – par Pauline Kael, en 1971, dans une paire d’articles intitulés « Raising Kane » – pour s’être attribué, au sens propre comme au figuré, le mérite de ce qui appartenait au scénariste, Herman J. Mankiewicz, comme si son scénario était la source première de son importance. C’est une étude fascinante. Kael réserve ses plus grands éloges à la performance de Welles ; ce qu’elle loue de la mise en scène de Welles, c’est son esprit ludique – son ouverture aux suggestions de ses collaborateurs et sa fouille dans les sacs de trucs qu’il a obtenus d’autres films. Selon Kael, Welles avait besoin du système pour réaliser sa grandeur, et ses films se sont aggravés lorsque, possédé par l’idée de sa propre grandeur, il n’était plus capable de bien jouer avec les autres (c’est-à-dire lorsqu’il ne pouvait plus trouver sa place dans le système des studios). À son avis, quelle que soit la marque personnelle de grandeur de Welles, c’est en grande partie le système qui a rendu ses films grands.
Kael écrit qu’elle avait vingt et un ans quand « Citizen Kane » est sorti; Elle était une cinéphile vorace, dit-elle, et a vu le film en termes de place dans l’industrie et les conventions de l’époque. Elle dit qu’avec le recul (c’est-à-dire détaché de son contexte), il est beaucoup plus excitant, mais l’un de ses objectifs est de le réintégrer dans son contexte, un contexte dans lequel les chefs de studio exerçaient un pouvoir maximal sur leurs productions. Les studios ne seraient plus jamais des entités aussi étroitement liées et unifiées ; « Citizen Kane » a contribué à faire ce que F. Scott Fitzgerald imaginait qu’un grand producteur dirait sur son lit de mort : « Quand Stahr est malade, il n’arrête pas de dire de le rendre aux réalisateurs. Ne le laissez pas à ces hommes. Rends-le-moi. Je l’ai enlevé à etc.
Le film de studio des années trente, produit de manière serrée, est resté la vision de Kael de ce que devrait être un film hollywoodien. C’est pourquoi, dans les années 1950, quand Hollywood a éclaté dans un élan kaléidoscopique d’invention de mise en scène, avec des films qui ont troqué l’uniformité et la douceur d’une époque antérieure pour des visions personnelles extravagantes, elle l’a damné, dans l’un de ses premiers articles majeurs (« Movies, the Desperate Art »). Négligeant ou, dans certains cas, répudiant certains films extraordinaires, elle considérait une période de créativité de mise en scène comme une période de décadence et d’échec. Elle n’avait pas non plus une grande opinion d’Hitchcock (du moins, pas des films de l’épanouissement de son génie, ceux des années cinquante et du début des années soixante). Elle a reconnu le génie de Godard, bien qu’avec un enthousiasme intermittent et capricieux (se détournant également de ses films ultérieurs). Son éloge mitigé et condescendant de « Citizen Kane », en le revoyant, à trente ans de sa sortie, est révélateur :
Maintenant, le film résume et préserve une époque, et l’iconoclasme juvénile est préservé dans toute sa fraîcheur, même la fraîcheur de sa légèreté… La « magie » de Welles, son extraordinaire plaisir à jouer la comédie et à faire illusion et à impressionner le public – ce qui semble si charmant dans le film aujourd’hui – était ce qui me semblait idiot à l’époque. C’était du Pop Gothic rebondissant à une époque où le terme « bande dessinée » appliqué aux œuvres d’art était encore un terme abusif. Aujourd’hui, la découverte de Welles sur la réalisation de films – et l’enfantillage et l’excitation de cette découverte – sont préservées dans Kane de la même manière que la scène de la neige est préservée dans la boule de verre.
Kael tapota la tête du propriétaire de Rosebud. Elle a fait l’éloge de « Citizen Kane » en regardant en arrière – avec nostalgie, comme un vestige du système des studios, aux enthousiasmes de sa propre jeunesse, et à ceux de Welles, plutôt qu’à l’avenir, à la jeunesse auto-renouvelée du cinéma qu’il a inspirée, et à la conscience tragique des procès futurs qu’il annonçait. Quoi qu’il en soit, elle est passée à côté d’une grande partie de cet avenir, même s’il appartenait déjà au passé.

Richard Brody a commencé à écrire pour The New Yorker en 1999. Il écrit sur les films dans son blog, The Front Row. Il est l’auteur de « Tout est cinéma : la vie professionnelle de Jean-Luc Godard ».
Views: 4






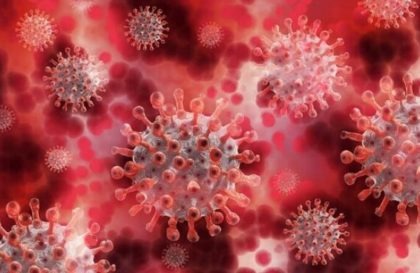
jay
« Welles a joué l’équivalent visuel de la libération de l’orchestre de la fosse, pour jouer des symphonies. » Quelle remarque ! !